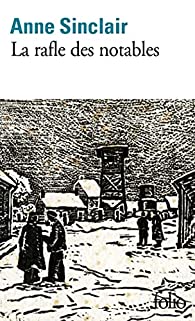Résumé
La
Rafle des notables revient sur un épisode de l’Occupation, peu
connu du grand public, où le grand-père paternel d’Anne
Sinclair s’est trouvé entraîné.
En décembre 1941, les
Allemands arrêtent 743 Juifs français, chefs d’entreprise,
avocats, écrivains, magistrats : une population privilégiée
(d’où le surnom de « notables »). Ils y adjoignent 300 juifs
étrangers déjà prisonniers à Drancy. Ils les enferment tous au
camp de Compiègne, sous administration allemande, et qui était
un vrai camp de concentration nazi en France, avec famine, manque
d’hygiène, maladies, conditions de vie épouvantables par un
des hivers les plus froids de la guerre. Une cinquantaine décède
dans le camp. Le but est l’extermination, et de fait, c’est de
ce camp que partira, en mars 1942, le premier convoi de déportés
de France vers Auschwitz (avant juillet 1942 et la Rafle du Vel
d’hiv).
Le grand-père paternel d’Anne Sinclair, Léonce,
petit chef d’entreprise, a été arrêté, interné à Compiègne
et sauvé de la déportation car il était tombé très malade et
avait été transféré – toujours détenu - à l’hôpital du
Val-de-Grâce d’où sa femme a réussi à le sortir. Ils se
cacheront jusqu’à la Libération où il est mort à 63 ans des
suites de son internement.
L’auteur, qui recherchait des
documents sur cette partie de la famille, a trouvé quelques
éléments sur ce grand-père (en cahier photo dans le livre).
Mais elle a surtout découvert un chapitre méconnu de la
persécution sous l’Occupation qu’elle a voulu raconter. Elle
redonne vie à ces prisonniers qui, pour la plupart, terminèrent
ce sinistre périple dans une chambre à gaz. Elle décrit la vie
quotidienne dans le camp entre des bourgeois assimilés à la
France depuis des générations et qui ne comprennent pas pourquoi
on les affame et les enferme, et des juifs étrangers qui ont
l’habitude des persécutions. Peu à peu, la force abandonne les
prisonniers, la famine les tue à petit feu, la vermine les
attaque, la gangrène s’installe. Son livre raconte avec émotion
cette descente aux enfers où la figure du grand-père illustre un
récit très personnel et inédit où l’enquête personnelle et
familiale rejoint l’enquête historique.